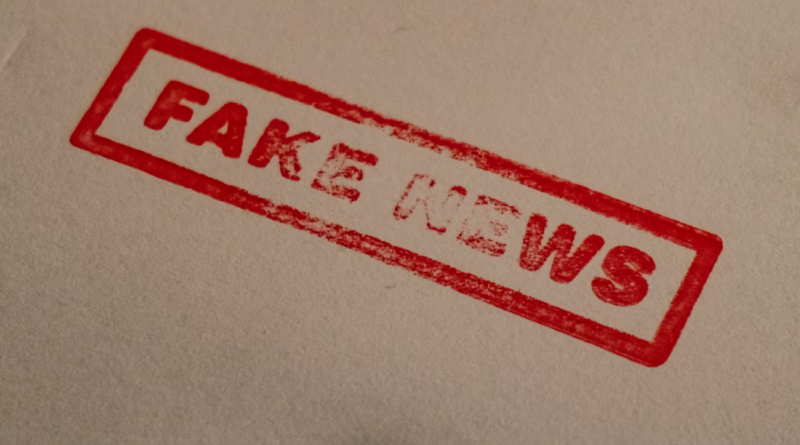Désinformation en santé : un rapport sans idées nouvelles et une méthodologie qui interroge
Constats déjà largement documentés, solutions connues reconditionnées et glissement vers des réponses rigides, centralisées et répressives : le rapport remis à la ministre de la Santé peine à ouvrir des perspectives nouvelles, tout en reléguant la médiation au second plan. L’affichage d’une large concertation masque une forte homogénéité des acteurs mobilisés, qui oriente le dispositif proposé vers l’administration de la défiance plutôt que la restauration de la confiance
Sous couvert d’approche nationale et s’appuyant sur des diagnostics connus de longue date tout en écartant les leviers relationnels, le rapport remis à Stéphanie Rist propose une stratégie normative, centralisée et aux velléités répressives, qui interroge ses effets à long terme sur la confiance, le débat scientifique et la liberté d’expression. Présenté comme une réponse structurante à un phénomène complexe, il privilégie l’outillage institutionnel et le cadrage des discours au détriment d’une réflexion approfondie sur les conditions sociales, culturelles et relationnelles de la circulation de l’information en santé. L’occasion de proposer une stratégie véritablement innovante, capable de retisser du lien plutôt que de le réguler, s’en trouve largement manquée.
Un diagnostic désormais largement consensuel
Le rapport dresse un tableau familier : circulation accélérée de contenus trompeurs, confusion entre opinions et savoirs établis, difficulté du public à hiérarchiser les sources, fragilisation de la parole scientifique dans l’espace médiatique. La crise sanitaire du Covid-19 a servi de révélateur à ces phénomènes, en les rendant visibles à grande échelle.
Ce diagnostic est solide. Mais il est aussi ancien. Les sciences sociales, l’infodémiologie et la médiation scientifique analysent ces mécanismes depuis plus d’une décennie. Les institutions européennes et internationales ont multiplié les rapports sur les liens entre information, confiance et santé publique. De nombreuses initiatives citoyennes et associatives ont expérimenté, souvent avec peu de moyens, des réponses éducatives et participatives.
Le rapport s’inscrit clairement dans cette continuité. Il ne renouvelle ni les concepts, ni les cadres d’analyse, mais les reformule dans un langage institutionnel.
Une mission construite dans un entre-soi informationnel
Le choix des rapporteurs constitue un élément central pour comprendre la tonalité du document. Tous sont issus d’un même espace : celui des controverses sanitaires très polarisées sur les réseaux sociaux. Tous ont été, à des degrés divers, des acteurs engagés dans les débats autour du Covid-19, et particulièrement identifiés par leur opposition frontale à certaines figures médiatiques devenues emblématiques de ces conflits.
Ce profil homogène ne disqualifie pas le travail produit, mais il en oriente fortement la perspective. Le rapport adopte une lecture du problème largement façonnée par les logiques propres aux réseaux sociaux : affrontements discursifs, personnalisation des controverses, construction de camps antagonistes, polarisation et escalade quel que soit le camp. D’autres approches, pourtant essentielles pour comprendre la défiance telles que sociologie des institutions, relation de soin, médiation de terrain, sciences de l’éducation et de la communication restent marginales.
Ce biais initial explique en partie la difficulté du rapport à se décentrer des conflits passés pour penser des réponses véritablement prospectives. Il explique également sans doute le biais de sélection des entretiens qui a précipité l’initative dans cet entre-soi peu propice aux idées nouvelles.
Qui parle ? Des entretiens nombreux, mais dans un périmètre étroit
Le rapport met en avant un chiffre impressionnant : 156 entretiens, ayant mobilisé près de 270 personnes. Ce volume donne l’image d’une consultation large et pluraliste. Pourtant, la lecture attentive des profils auditionnés révèle un périmètre nettement plus homogène qu’il n’y paraît. Les personnes interrogées appartiennent majoritairement à trois catégories : militants numériques (réseaux sociaux) en croisade dont leurs relais habituels au sein de médias et autres fact-checkers, représentants de la fonction publique (institutions sanitaires, universitaires, chercheurs, société sanvantes). Il s’agit, pour l’essentiel, de personnes déjà convaincues de la centralité du problème et largement alignés sur le diagnostic posé par les rapporteurs. À l’inverse, le rapport reste discret, voire silencieux, sur l’audition de profils susceptibles de déplacer le regard : associations citoyennes et de médiation scientifique, médiateurs indépendants de terrain, soignants de premier recours confrontés à la défiance des patients, chercheurs en sciences sociales critiques des politiques publiques de communication, Leur absence interroge. Ainsi, derrière l’affichage d’une consultation large et exhaustive, la composition du panel révèle un angle unique, la pluralité des expériences et des points de vue non institutionnels demeurant très largement marginalisée.
Un noyau militant polarisé bruyant comme illusion du consensus
L’analyse détaillée de la liste nominative révèle une configuration plus problématique encore.
Environ 15 à 20 % des personnes consultées sont un noyau d’acteurs fortement polarisés constitué récemment (pandémie du Covid-19), très actifs sur les réseaux sociaux, engagés dans des luttes souvent politisées et structurées autour de conflictualités personnalisées. Ces personnes revendiquent une posture scientifique tout en mobilisant des pratiques caractéristiques du militantisme numérique : interpellations publiques agressives, campagnes coordonnées, judiciarisation systématique des controverses et mise en scène récurrente de leur victimisation. Les rapporteurs s’inscrivent eux-mêmes dans ces réseaux d’interactions, brouillant davantage la frontière entre expertise, engagement et combat personnel. Pour enfoncer le clou, comme précédemment indiqué, des journalistes liés à ce noyau militant et constituant sa fidèle chambre d’écho dans les médias, ne manquent pas à l’appel.
Numériquement minoritaire mais très bruyant, ce noyau entretient une forte circularité discursive faite de citations croisées, de références mutuelles et de reprises d’arguments identiques d’un support à l’autre.
À cette dynamique s’ajoute donc la surreprésentation d’acteurs institutionnels issus des mêmes cercles de diffusion, certains ayant pu être sollicités via les réseaux professionnels et la liste des lecteurs du blog personnel d’un autre rapporteur.
La consultation donne ainsi à voir moins une confrontation pluraliste des approches qu’un écosystème fermé, où les sources, les analyses et les relais médiatiques tendent à se recouper, nourrissant un effet d’auto-validation dans lequel le consensus affiché apparaît en partie produit par l’entre-soi et l’auto-citation plutôt que par la diversité réelle des cadres d’analyse.
Un entre-soi cognitif plus qu’un pluralisme réel
Ce biais de sélection ne relève pas nécessairement d’une intention, mais il produit un effet bien identifié en sociologie des organisations : l’entre-soi cognitif. En interrogeant majoritairement des acteurs issus des mêmes sphères professionnelles et informationnelles, voire des compagnons de millitantisme, sphères souvent très actives sur les réseaux sociaux, le rapport consolide des cadres d’analyse déjà dominants sans les mettre réellement à l’épreuve.
Cette homogénéité explique en partie pourquoi les recommandations finales apparaissent si peu contrastées. Les constats convergent, les solutions se ressemblent, et les tensions inhérentes à toute politique de l’information en santé sont peu explorées. Le débat scientifique, pourtant fondé sur la confrontation d’approches et de disciplines, se trouve ici lissé au profit d’un consensus de surface.
Interroger la désinformation sans interroger ses propres conditions de production constitue une limite méthodologique majeure. En ce sens, le rapport illustre paradoxalement ce qu’il dénonce : la difficulté à sortir de cadres interprétatifs fermés lorsqu’un problème est abordé sous un angle trop homogène.
L’absence de cartographie d’analyse des personnes auditionnées, c’est-à-dire les disciplines, les positions institutionnelles, les degrés d’engagement public, empêche toute évaluation indépendante de la pluralité réelle des points de vue. Cette lacune est d’autant plus problématique que le rapport plaide par ailleurs pour plus de transparence et de rigueur dans l’information en santé.
Des solutions connues, reconditionnées
Les principales recommandations du rapport relèvent davantage de la formalisation que de l’innovation. L’idée d’un indicateur de fiabilité de l’information en santé, inspiré du Nutri-Score, illustre cette logique. Or il s’agit d’une solution de labellisation de l’information qu’a préconisé récemment Emmanue Macon. Coïncidence ? Quoi qu’il en soit, présentée comme structurante, elle reprend une proposition ancienne, régulièrement discutée dans les milieux de la médiation scientifique. Les limites sont bien identifiées : réduction excessive de la complexité, dépendance aux critères retenus, risque de rejet par les publics déjà défiants envers les institutions.
De même, la création d’un observatoire national et d’un dispositif d’infovigilance prolonge des dispositifs existants sans démontrer en quoi une nouvelle structure résoudrait les problèmes de coordination, de légitimité et d’efficacité déjà rencontrés. Le rapport privilégie une réponse organisationnelle, rajoutant une couche organisationnelle comme on ajoute une loi au millefeuille existant, à un problème qui est pourtant aussi, fondamentalement, relationnel et culturel.
Angle mort du rapport : ce que font les autres pays européens
C’est aussi une composante de l’entre-soi qui transpire de ce travail, réduisant la problématique à un sujet hexagonal. Le rapport évoque à plusieurs reprises le cadre international et européen, sans toutefois proposer de véritable analyse comparative des stratégies mises en œuvre dans d’autres pays. Cette absence est regrettable : elle prive la réflexion de retours d’expérience pourtant précieux, dans un domaine où les réponses éducatives, participatives ou fondées sur la médiation ont parfois montré des résultats plus durables que les approches strictement normatives.
La comparaison européenne aurait pourtant apporté un éclairage utile. Dans plusieurs pays, les stratégies de lutte contre la désinformation en santé privilégient des approches plus distribuées. Les pays nordiques, notamment, investissent prioritairement dans l’éducation aux médias et à la science dès le plus jeune âge, en s’appuyant sur des partenariats étroits entre écoles, chercheurs et acteurs associatifs.
En Allemagne ou aux Pays-Bas, les dispositifs de veille existent, mais sont souvent accompagnés d’un effort marqué de transparence institutionnelle et d’un soutien à des plateformes de médiation indépendantes. L’accent est mis moins sur la labellisation ou la sanction que sur la capacité du public à comprendre les incertitudes scientifiques.
Ces expériences montrent que la réponse à la désinformation ne se limite pas à l’outillage réglementaire, mais repose sur un écosystème de confiance construit dans le temps.
Une conception verticale et autoritaire de la confiance
Le rapport français repose implicitement sur une idée simple : apposer un tampon de score sur l’information et secondairement améliorer la qualité de l’information disponible suffirait à restaurer la confiance. Cette approche néglige une dimension pourtant centrale des crises récentes : la défiance ne procède pas uniquement d’un déficit de connaissances, mais d’une perte de pensée critique et d’un rapport dégradé aux institutions.
Les messages contradictoires, les revirements mal expliqués, les zones d’ombre sur les processus de décision ont durablement entamé la crédibilité de la parole publique. Sur ce point, le rapport reste discret et ainsi, politiquement correct. Il interroge peu la responsabilité des institutions dans la perte de confiance qu’il constate par ailleurs. Il faut dire que les voix qui s’expriment dans ce rapport sont pour l’écrasante majorité les institutions elles-mêmes.
Le risque d’un tournant répressif mal encadré
La volonté de mieux protéger les scientifiques face au harcèlement est légitime. Mais la place accordée aux sanctions dans le rapport soulève des questions importantes. Les frontières entre désinformation, erreur, controverse scientifique et critique légitime ne sont ni simples ni stables. En l’absence de garde-fous clairement définis, toute approche répressive comporte un risque de confusion entre régulation de contenus manifestement frauduleux et contrôle du débat scientifique.
Dans un contexte où la science progresse par la confrontation d’hypothèses, ce glissement mérite une vigilance particulière.
Un rapport utile à la formalisation, mais insuffisant et biaisé
Ce rapport remplit une fonction politique claire : structurer un discours public sur la désinformation en santé et légitimer des orientations déjà présentes dans le débat institutionnel. Il est moins convaincant comme texte analytique et prospectif. Il peine à intégrer la pluralité des expériences de terrain et des points de vue, à reconnaître les limites de l’action institutionnelle et à proposer des outils réellement nouveaux.
Repenser la lutte contre la désinformation
Lutter durablement contre la désinformation en santé suppose d’accepter une part d’inconfort. Celui de l’incertitude scientifique, du débat contradictoire et de la critique des institutions elles-mêmes. Les réponses les plus efficaces observées en Europe reposent sur la médiation, l’éducation, la transparence et le dialogue, bien plus que sur la labellisation ou la sanction. À défaut, le risque est réel de transformer la lutte contre la désinformation en un nouvel objet de défiance.
La médiation scientifique, un angle encore largement sous-exploité
Un aspect frappant du rapport est la place marginale accordée à la médiation scientifique, pourtant identifiée depuis longtemps comme un levier central de confiance. Là où le texte privilégie des réponses descendantes, labellisation, observatoires, dispositifs de surveillance, la médiation repose sur une logique inverse : créer des espaces d’échange où les savoirs circulent, se discutent et se contextualisent.
La médiation ne se réduit pas à une simplification des contenus scientifiques. Elle suppose un travail patient d’explicitation des incertitudes, des controverses et des processus de production des connaissances. Elle reconnaît que la défiance n’est pas seulement un déficit d’information, mais souvent une réaction à un sentiment d’exclusion du débat ou à une expérience antérieure de dissonance institutionnelle.
En France comme ailleurs en Europe, les initiatives de médiation portées par des associations, des collectifs de chercheurs ou des journalistes spécialisés ont montré leur capacité à toucher des publics éloignés des canaux institutionnels. Ces dispositifs, lorsqu’ils sont indépendants, pluralistes et inscrits dans la durée, favorisent une appropriation active des savoirs, bien plus efficace que toute tentative de normalisation des discours.
En reléguant la médiation au second plan, le rapport passe à côté d’une voie pourtant prometteuse : celle d’une politique de l’information fondée sur la relation, la confiance construite et la reconnaissance du citoyen comme acteur du débat scientifique, et non comme simple destinataire à corriger.
L’entre-soi médiatique : une chambre d’écho bien rodée
La publication du rapport a donné lieu à une séquence de prises de parole d’une remarquable homogénéité. Plusieurs grands médias nationaux (L’Express, Le Point, Libération notamment) ont relayé, à un rythme soutenu, la parole des mêmes rapporteurs, selon un cadrage identique et un lexique commun. Cette convergence n’a rien de spontané : elle repose sur des journalistes intégrés dans le réseau militant polarisé et bruyant, souvent auditionnés dans le cadre même du rapport, et qui en deviennent ensuite les relais naturels. L’entre-soi, ici, ne se limite plus à la production du diagnostic ; il s’étend à sa mise en scène médiatique et à sa validation publique, au prix d’une pluralité d’angles largement absente.
La prise de distance de l’exécutif : un signal politique fort
Face à cette séquence médiatique très alignée, la ministre de la Santé Stéphanie Rist, qui n’a ni lancée cette mission ni désigné les rapporteurs, a toutefois introduit une inflexion notable. Si la stratégie gouvernementale s’appuie sur le rapport, elle n’en reprend pas plusieurs propositions structurantes. Ont ainsi été écartées la création d’un « Info-score santé », assimilable à une notation normative des sources d’information, l’instauration de sanctions spécifiques à l’encontre des producteurs de contenus, ou encore une judiciarisation renforcée de la lutte contre la désinformation. La ministre a également renoncé à confier l’infovigilance à une instance indépendante, privilégiant une mise en œuvre plus progressive et prudente. Ces arbitrages traduisent une conscience aiguë des risques politiques, juridiques et démocratiques associés à une approche trop coercitive de l’information scientifique.
Quand la lutte se mue en guerre informationnelle
Cette retenue gouvernementale contraste avec le discours porté par les rapporteurs dans l’espace médiatique et sur les réseaux sociaux. À mesure que leurs interventions se multiplient, un glissement s’opère : la désinformation n’est plus pensée comme un phénomène complexe à analyser, mais comme une menace à neutraliser ; le débat public comme un espace à réguler ; les plateformes numériques, jusqu’à l’évocation explicite de leur fermeture, comme des problèmes à éliminer. Ces positions, même lorsqu’elles ne sont pas retenues par l’exécutif, révèlent une conception de la lutte contre la désinformation fondée d’abord sur la contrainte, la normalisation et la répression, reléguant au second plan la médiation, l’accompagnement et le travail sur la confiance.
Le rapport peine ainsi à reconnaître la frontière poreuse entre expertise scientifique, engagement militant et logique de guerre informationnelle. Lorsque des rapporteurs adoptent eux-mêmes, sur les réseaux sociaux, une posture vindicative et judiciarisée, appelant implicitement à des sanctions plutôt qu’à des mécanismes de délibération contradictoire, ils donnent corps aux inquiétudes que suscite ce texte. La question dépasse dès lors le seul champ de l’information en santé : elle engage notre capacité collective à répondre à la défiance sans refermer l’espace du débat, ni affaiblir le pluralisme et la démocratie que cette politique prétend pourtant défendre.
Rapport « désinformation en santé » : un arrière-goût orwellien ?
Au terme de cette analyse, une impression domine : ce qui devait être une mission de réflexion s’est progressivement transformé en tentative de reprise autoritaire du contrôle de l’espace informationnel. Sous couvert de lutte contre la désinformation scientifique, le rapport laisse affleurer une vision profondément scientiste du débat public, où la controverse est disqualifiée, la contradiction délégitimée et la sanction érigée en réponse politique. Il transpire de cet exercice l’idée d’une expédition punitive menée par le haut, visant à institutionnaliser la revanche d’un noyau militant bruyant, celui-là même dont les rapporteurs sont partie prenante sur les réseaux sociaux, pour tenter de gagner, par l’appareil d’État, une guerre numérique qui peine à convaincre dans l’espace ouvert du débat.
En prétendant protéger la démocratie sanitaire, le rapport en fragilise les fondements : pluralisme des savoirs, délibération contradictoire, médiation scientifique, et même, médiation tout cours comme maître-mot. La défiance n’y est pas travaillée, elle est contenue ; la complexité n’y est pas éclairée, elle est normalisée. L’ombre d’un ministère de la Vérité version scientifique, longtemps invoquée comme une caricature excessive, se trouve ici formulée de manière bien réelle. La lutte contre la désinformation ne saurait pourtant justifier que l’on referme l’espace démocratique au nom de sa défense.
Illustration d’en-tête : Samuel Regan-Asante
Cet article GRATUIT de journalisme indépendant à but non lucratif vous a intéressé ? Il a pour autant un coût ! Celui d’une rédaction qui se mobilise pour produire et diffuser des contenus de qualité. Qui paie ? vous, uniquement, pour garantir notre ultra-indépendance. Votre soutien est indispensable.
Science infuse est un service de presse en ligne agréé (n° 0324Z94873) édité par Citizen4Science, association à but non lucratif d’information et de médiation scientifique.
Notre média dépend entièrement de ses lecteurs pour continuer à informer, analyser, avec un angle souvent différent, car farouchement indépendant. Pour nous soutenir, et soutenir la presse indépendante et sa pluralité, faites un don pour que notre section presse reste d’accès gratuit !
via J’aime l’Info, association d’intérêt général partenaire de la presse en ligne indépendante :
ou via la page dédiée de J’aime l’Info, partenaire de la presse en ligne indépendante